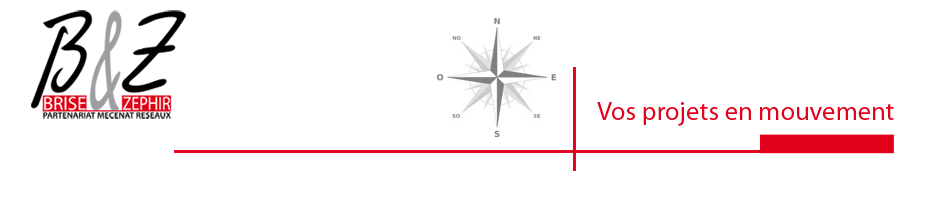![]() Pour continuer à opérer dans un univers ultra-concurrentiel, les ONG intègrent dans leur équipe des spécialistes de la collecte de fonds : les fundraisers.
Pour continuer à opérer dans un univers ultra-concurrentiel, les ONG intègrent dans leur équipe des spécialistes de la collecte de fonds : les fundraisers.
Méconnu il y a encore quelques années, le métier de fundraiser – en français, professionnel de la collecte de fonds et du mécénat – s’est imposé dans le paysage associatif et au-delà. En cause : la baisse des subventions publiques et l’accroissement du nombre de structures, qui obligent ces dernières à diversifier leurs sources de financement pour continuer à exister et se développer. La seule communication ne suffisant plus, les structures n’hésitent plus à recruter ces spécialistes aux parcours divers, comme en témoigne cette galerie de portraits.
par Eugénie Rieme
Si l’histoire de la philanthropie en France est liée à son histoire religieuse, elle repose aussi sur la politique interventionniste de l’État mise en place après la Seconde guerre mondiale. En effet, l’avènement d’un État providence dans l’Hexagone se distingue des pays anglo-saxons par son soutien à la solidarité nationale, suppléant, de fait, une partie des dons des individus ou des organismes. Ce n’est qu’à partir des années 1970 que les premiers fundraisers font leur apparition en France. Les techniques de marketing direct utilisées pour la vente par correspondance sont adaptées à la collecte de fonds des organismes à but non lucratif. Elles permettent aux organisations de se constituer des bases de données (fichiers donateurs) et d’établir une stratégie de collecte. “En se professionnalisant, les associations cherchent à gagner en performance”, indique Sophie Barniaud, cofondatrice de Carenews Group, société de services et de conseil en stratégie de mécénat. C’est ainsi que les premiers départements dédiés au développement de structures et les agences de conseil en communication et collecte voient le jour.
Sur le plan législatif, la fiscalité s’adoucit au profit des donateurs (loi Balladur du 23 juillet 1983, loi Aillagon du 1er août 2003, loi Pécresse et loi “Tepa” des 10 et 21 août 2007, loi du 21 juillet 2009 sur la réforme de l’hôpital). Cette politique incitative légitimise le métier de fundraiser en France. Au milieu des années 1990, la crise de confiance des donateurs à la suite du scandale de l’Association pour la recherche sur le cancer (Arc), à laquelle s’ajoute la baisse des subventions publiques, complexifient la tâche des fundraisers. Aujourd’hui, le fundraising touche des secteurs d’activité très divers tels que l’environnement, la santé, l’enseignement supérieur et la recherche, la culture ou encore la solidarité nationale et internationale.
Go-between
De plus en plus décomplexées et conscientes de leurs besoins croissants de financements, les structures misent sur le fundraising – et notamment les partenariats privés – pour se développer. Et au vu du nombre de structures existantes, la concurrence est rude. Pour acquérir de la reconnaissance et asseoir leur notoriété auprès des donateurs, des outils existent. “Depuis 2010, les structures peuvent prétendre au Label Ideas, délivré par un comité d’experts tripartite et indépendant, issu des métiers du chiffre et de l’associatif. Ce label a pour but de valoriser les associations et fondations qui ont un fonctionnement vertueux”, déclare Suzanne Chami, responsable du développement à Ideas.
Plus largement, cette association conseille et accompagne les structures qui le souhaitent en construisant des passerelles entre le monde de la philanthropie et le secteur associatif. “Les fundraisers ont besoin d’une structure qui fonctionne bien pour attirer des mécènes”, poursuit Suzanne Chami. Et notamment les PME, lesquelles représentent un véritable enjeu dans la stratégie de diversification des financements des structures. Investies dans une démarche d’engagement sociétal, les entreprises sont plus enclines à se lancer dans des projets de mécénat. “Les échanges entre structures et entreprises sont de fait devenus plus équilibrés. Charge aux fundraisers de pérenniser ces relations”, constate Sophie Barniaud de Carenews. Un travail de longue haleine qui nécessite une mobilisation en interne. “Car il ne suffit pas de faire du fundraising pour lever des fonds, une dynamique de mobilisation interne est nécessaire”, déclare Yaële Aferiat de l’Association française des fundraisers.
L’éducation des consciencesMagistère en marketing direct à l’IAE de Lille en poche, Ophélie Ruyant débute sa carrière dans la société Bisnode, spécialisée entre autres dans l’analyse de données. Elle y reste 4 ans. “Je faisais de la prospection papier et travaillais à l’amélioration des fichiers clients du secteur caritatif, ma motivation première en intégrant l’entreprise.” Sur le plan personnel, Ophélie revient d’une année de bénévolat aux Philippines au côté de l’ONG Virlanie qui œuvre auprès des enfants des rues de Manille. Une année qui l’a confortée dans l’idée de travailler dans le commerce équitable ou l’humanitaire. “Mon souhait était de ré-accorder mon métier avec un domaine d’activité plus tourné vers les autres.” Son vœu s’exauce en 2009, lorsqu’elle intègre l’équipe de Solidarités International (SI) en tant que chargée de la collecte de fonds.
“Je gérais à la fois une chargée de relation donateurs et une assistante en stage.” Le fonctionnement familial, de par la petite taille de la structure, est l’occasion pour Ophélie de travailler en étroite collaboration avec les autres membres de l’association. Et ainsi d’avoir une vision globale du secteur de l’humanitaire. “À mon arrivée, l’équipe comptait moins de 50 personnes, contre 80 aujourd’hui. Avec un budget annuel qui est passé de 40 à 70 millions d’euros en l’espace de 5 ans.” En 2014, la collecte via le marketing direct a rapporté près de 3 millions d’euros. “Un montant qui représente peu au regard de notre budget global, mais qui est pourtant essentiel car garant de notre réactivité face aux urgences. Compte tenu du contexte économique difficile et du recentrage des donateurs sur les causes nationales, la part de notre collecte auprès du grand public tend à baisser. L’enjeu est donc de développer un nouveau modèle stratégique pour être moins fragile”, poursuit-elle.
Un travail qui suppose de multiplier les canaux de communication. Car si le papier tend à devenir obsolète, il demeure encore le média privilégié des donateurs, jeunes retraités pour la plupart. “Plus économique et dans l’ère du temps, le Web peine toutefois à capter de nouveaux donateurs”, ajoute la fundraiser. “Des sociétés de data-intelligence, sorte de grosses bases de données, nous aident à cibler au mieux les profils socio-démographiques et socio-comportementaux des donateurs potentiels.” Gage ensuite à l’association de faire passer son message en respectant une certaine éthique. L’une des méthodes de SI est d’interpeller les donateurs par le biais de photos. Un outil de communication délicat que l’ONG entend utiliser avec prudence et respect. “Notre but est d’éduquer les consciences, de faire de la pédagogie dans le message, et de se garder de tout voyeurisme”, conclut Ophélie Ruyant.
Du donateur à l’ambassadeurAprès un passage par Sciences-Po Bordeaux, Laurence Langou poursuit son cursus au Celsa avec un Master2 Communication des institutions publiques. Une formation professionnalisante qui l’a amenée à réaliser des stages en entreprises et au sein de fondations d’entreprises impliquées dans le mécénat culturel, et de fondations de particuliers.
Poussée par l’envie de travailler dans le milieu culturel, elle décroche son premier emploi de chargée de communication et mécénat en 2005. “J’avais en charge l’organisation du 8e concours Rostropovitch organisé par la Ville de Paris et l’Association pour la création et la diffusion artistique (Acda) de Claude Samuel. Ce poste m’a donné l’occasion de faire mes armes dans le fundraising.” Forte de cette expérience, la jeune fundraiser, désireuse de parfaire ses connaissances en mécénat et avide de découvertes, s’expatrie en Australie. Son poste : responsable marketing et développement pour les chœurs de l’Opéra de Sydney. “Dans les pays anglo-saxons, l’argent n’a pas la même valeur qu’en France. Il n’y a pas de dichotomie entre culture universitaire et entreprise”, souligne Laurence Langou.
En 2007, Laurence revient en France, année où est promulguée la loi relative à l’autonomie des universités. Sous l’effet de cette loi, beaucoup d’universités créent leur fondation. Elle délaisse alors son secteur de prédilection, la culture, pour l’enseignement supérieur, et devient responsable “grands donateurs” au sein de la fondation Bordeaux Université. “Ma mission consiste à recruter et à fidéliser des hauts revenus, particuliers ou entreprises, présentant un potentiel de dons élevés, c’est-à-dire d’au moins 10 000 euros, dans le cas de la fondation Bordeaux Université. Cela suppose la mise en place d’une relation directe et personnalisée avec chaque grand donateur”, précise celle-ci.
Pour les séduire, la fundraiser s’appuie sur des réseaux déjà existants : la gouvernance de l’université et les anciens élèves. “Les prospects sont identifiés avant d’être approchés lors de rencontres ou d’événements organisés par la fondation.” Ces moments privilégiés sont aussi l’occasion de leur présenter les opportunités qui leur sont offertes, comme la participation au comité de pilotage ou à une chaire de formation. “Il s’agit de la phase dite de ‘cultivation’ ”, détaille Laurence Langou. Le grand donateur est ensuite sollicité financièrement. Dernière étape : la fidélisation. “En maintenant le lien, le donateur devient un ambassadeur, un porte-parole de la cause ou du projet qu’il défend.”
Le relationnel polyvalentPoussée par la nécessité de construire des ponts entre le monde privé et l’intérêt général, Céline Aimetti, alors manager marketing chez IBM, donne de son temps libre dans diverses structures dont l’association Seuil, “une alternative à l’incarcération des adolescents en France”.
Sa première expérience de bénévole ne date pas d’hier. “À l’âge de 14 ans, je participais déjà aux collectes de nourriture dans le supermarché du coin”, se rappelle-t-elle. Son parti pris : “tout le monde n’a pas la chance de faire des études et d’être bien traité pendant son enfance. C’est pourquoi il est important d’aider ceux qui sont en difficulté”. Insatisfaite dans sa vie professionnelle, Céline Aimetti quitte son travail et part faire de l’humanitaire en Afrique. À son retour, elle intègre le département à but non lucratif de l’agence de communication TBWA, après un stage à la fondation Nature & Découvertes. Elle y restera 3 années : “j’étais en charge d’élaborer la stratégie de collecte de clients issus du monde associatif”.
En parallèle de son travail, elle prépare le certificat français de fundraising délivré par l’Association française des fundraisers (Aff), l’occasion d’apprendre toutes les ficelles du métier. Par la suite, elle intègre l’ONG Aides, où elle crée le poste de responsable des partenariats privés et des grands donateurs avant de se lancer dans l’aventure Clubhouse France. “Financée à 90 % par des fonds privés, cette association a pour mission d’accompagner des personnes touchées par un handicap psychique dans leur réinsertion sociale et professionnelle”, précise Céline Aimetti. Le secret de sa réussite ? “Un bon relationnel, et une capacité à s’adapter à des publics très divers, du grand philanthrope au dirigeant d’entreprise. Sans oublier de la rigueur, de la persévérance et de l’originalité pour séduire les donateurs. Loin de travailler seul dans son coin, le fundraiser est un créateur de liens au service de la solidarité, un ambassadeur de l’action qui va fédérer de nouvelles relations.”
Face à cette demande croissante, certaines universités et grandes écoles de commerce et/ ou de management proposent des modules de cours sur les stratégies de collecte, à l’instar de l’université Paris Est-Créteil dans le cadre de sa licence professionnelle Communication des associations et des collectivités. L’AFF a également lancé, il y a 10 ans, un “certificat français du fundraising” en partenariat avec l’Essec. Cette formation, qui forme près de 1 500 personnes chaque année, aborde tous les aspects du fundraising nécessaires à la mise en place d’une bonne stratégie de collecte. Le but : “offrir aux professionnels du métier un socle de connaissances solide afin qu’ils adoptent de vrais réflexes structurants et n’aient pas une vision opportuniste du métier”, ajoute Yaële Aferiat. “Cette professionnalisation est aussi un enjeu pour les entreprises. Car pérenniser un projet de mécénat, c’est pérenniser les conditions du financement”, analyse Sophie Barniaud.
Profils et domaines de prédilection69 % des fundraisers sont des femmes, plutôt jeunes (62 % ont moins de 45 ans) travaillant à Paris (48 %), la féminisation ne cessant de progresser (53 % de femmes en 2009). 60 % des fundraisers (hommes et femmes confondus) ont suivi une formation en fundraising.
Leurs principaux domaines d’intervention : le partenariat entreprises (68,2 %), l’événeme ntiel (63,7 %), la communication (63,7 %), les “grands donateurs” (59,9 %) et le marketing direct (49,8 %).
Ce sont les secteurs de l’aide sociale en France/précarité et de l’humanitaire/urgence/développement qui collectent le plus de dons privés, car ils sont dominés par de grosses organisations.
Source : Enquête Fundorama – septembre 2014, le baromètre français des métiers du fundraising, réalisée par l’Association française des fundraisers.